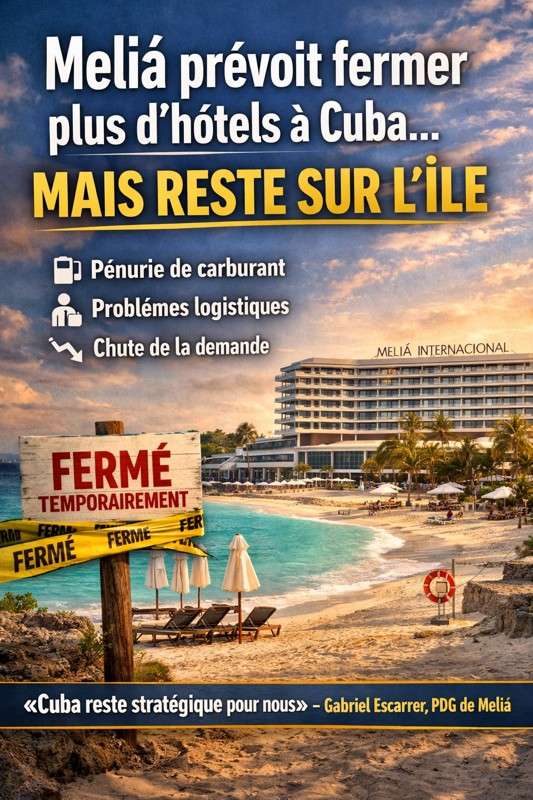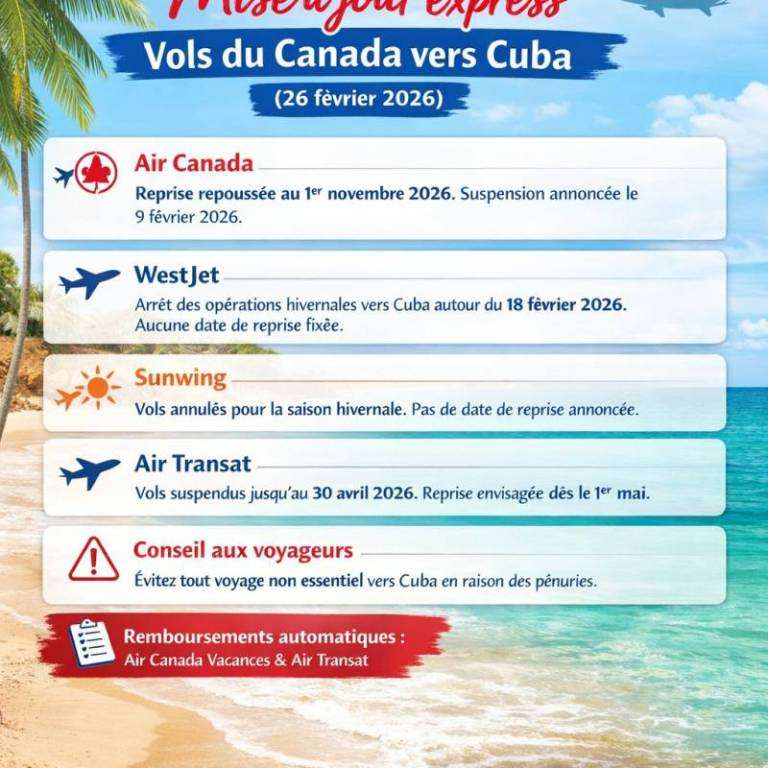Mystérieuse cité sous‑marine de Cuba : mythe, science et réalité
🌊 La mystérieuse cité sous‑marine de Cuba : mythe, science et réalité (mise à jour 2026)
Depuis plus de vingt ans, une énigme fascine autant les sci
Depuis plus de vingt ans, une énigme fascine autant les scientifiques que le grand public : l’existence possible d’une structure gigantesque au fond de l’océan, au large de l’ouest de Cuba. Certains y voient les traces d’une cité engloutie, potentiellement vieille de 6 000 ans ou plus, tandis que d’autres affirment qu’il ne s’agit que de formations géologiques naturelles.
🕰️ Origine de l’histoire : la découverte de 2001
En 2001, deux ingénieurs canado‑cubains, Paulina Zelitsky et Paul Weinzweig, travaillant pour la société Advanced Digital Communications (ADC), effectuent des scans sonar dans les profondeurs au large de la péninsule de Guanahacabibes.
Leurs instruments détectent alors :
Des formes géométriques rectilignes,
Ressemblant à des pyramides, des routes, et même des bâtiments,
Réparties sur environ 2 km²,
Entre 600 et 750 mètres de profondeur.
Ces images sonar évoquent un complexe urbain organisé, et certains experts ont estimé que les structures pourraient remonter à 6 000 ans, soit plus anciennes que les pyramides d’Égypte.
Cette annonce déclenche immédiatement un intérêt mondial et même des comparaisons avec l’Atlantide.
🧪 Réactions scientifiques : scepticisme et prudence
Malgré l’enthousiasme public, les scientifiques sont restés prudents dès le départ.
Ce que disent les experts :
Des géologues comme Manuel Iturralde‑Vinent, spécialiste cubain, rappellent que la nature peut créer des formes très régulières en profondeur, notamment par glissements sous‑marins ou érosion. [jpost.com]
Des archéologues marins comme Michael Faught soulignent qu’à 650 mètres, aucune civilisation connue n’aurait pu ériger des structures qui auraient ensuite sombré si profondément à l’époque suggérée. [uniladtech.com]
Paulina Zelitsky elle-même a reconnu qu’il serait « totalement irresponsable d’affirmer qu’il s’agit d’une ville sans preuve directe ». [uniladtech.com]
Autrement dit :
👉 les images sont intrigantes,
👉 mais aucune preuve solide d’origine humaine n’a été trouvée.
🛑 Pourquoi aucune étude approfondie n’a suivi ?
Depuis 2001, aucune expédition majeure n’a été menée, pour plusieurs raisons :
🔹 Coûts exorbitants
Explorer à plus de 600 mètres nécessite :
des ROVs ultra‑profonds,
des sous‑marins spécialisés,
des navires scientifiques rares et coûteux.
Les financements ont échoué, ce qui a déjà été confirmé par l’océanographe Sylvia Earle.
🔹 Difficultés politiques
Les eaux cubaines sont fortement réglementées.
Tout projet étranger nécessite une autorisation gouvernementale.
🔹 Absence de preuves concrètes
Sans artefacts, sans vidéos claires et sans échantillons géologiques, les institutions scientifiques internationales n’ont pas considéré ce site comme prioritaire.
Résultat :
👉 Le site est voir mais jamais revisité depuis plus de 20 ans.
🌍 Pourquoi l’histoire refait surface aujourd’hui ? (2024–2025)
Depuis 2024, des vidéos virales et des articles ont relancé l’intérêt pour cette « cité perdue ». Des médias comme le Jerusalem Post et The Cancun Post ont publié des synthèses sur le sujet en 2025, rappelant :
que les structures pourraient être très anciennes si elles étaient artificielles,
que leur forme rappelle des blocs, plateformes et pyramides,
mais aussi que la communauté scientifique demeure prudente en raison de l’absence de preuves directes.
🧭 Ce que l’on sait en 2025
✔️ Oui, les images sonar montrent des formes régulières.
✔️ Non, ce n’est pas confirmé comme une cité.
✔️ Aucun artefact n’a été trouvé.
✔️ Aucune expédition moderne n’a revisité le site.
✔️ Les experts restent divisés entre :
Hypothèse géologique naturelle (majoritaire),
Hypothèse archéologique (minoritaire, non confirmée).
🔮 Perspectives d’avenir
Pour vérifier la nature de ces structures, il faudrait :
envoyer un ROV profond équipé de caméras HD,
prélever des échantillons de roche,
effectuer une cartographie 3D de précision,
impliquer des géologues, archéologues et océanographes indépendants.
À ce jour, aucune mission financée n’est en préparation.
Mais avec les progrès rapides des technologies de cartographie sous‑marine et l’essor de l’IA pour analyser les données sonar, une nouvelle exploration future n’est pas exclue.
🧠 Conclusion : mythe fascinant, science incomplète
La mystérieuse « cité sous‑marine » de Cuba reste aujourd’hui :
un mystère non résolu,
un sujet très discuté mais sans preuves archéologiques,
un exemple parfait de la frontière entre fait scientifique et imaginaire collectif.
Qu’il s’agisse d’une formation naturelle ou d’une civilisation oubliée, il faudra des expéditions modernes pour enfin lever le voile sur ce site énigmatique.
Et d’ici là, il continuera d’enflammer les débats, les théories… et les rêves.